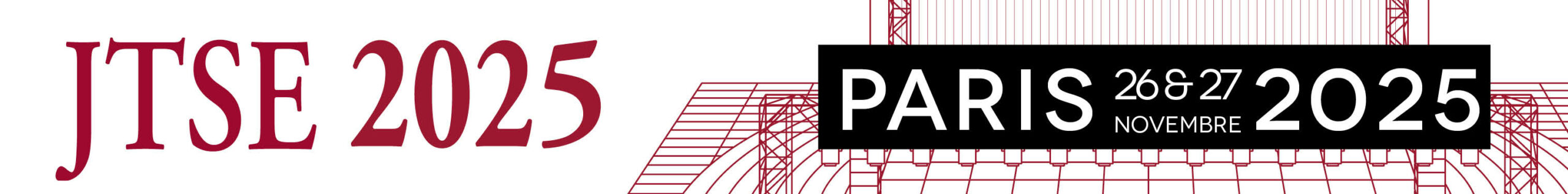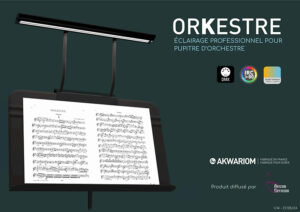“Une bonne scénographie comporte un vide”
Concepteur de décors et d’espaces sonores, éclairagiste, costumier ou encore photographe de plateau, le Belge Michel Boermans est bien plus qu’un scénographe : il est un homme de théâtre, au sens large du terme. Un touche-à-tout passionné qui coordonne depuis 1990 la pédagogie du département théâtre de l’INSAS (Institut supérieur des arts de la scène) de Bruxelles. Une fonction dont il se retire cette année pour prendre sa retraite. L’occasion de revenir avec lui sur une partie de sa carrière et sur les enseignements très transversaux de l’INSAS.
Comment avez-vous découvert le théâtre ?
Michel Boermans : Dans une classe d’école maternelle, avec une institutrice hors du commun. Une salle de spectacle se trouvait dans le complexe scolaire et nous faisions tous les ans une ou deux représentations. Curieusement, plusieurs de mes confrères sont passés par la même “filière” : nous avions eu la même institutrice et la même expérience qui nous avaient amenés à continuer le théâtre. Mes parents étaient par ailleurs extrêmement attachés au théâtre. Ils m’y ont emmené alors que j’étais très jeune. Je suis né à Liège et cette ville est associée à la