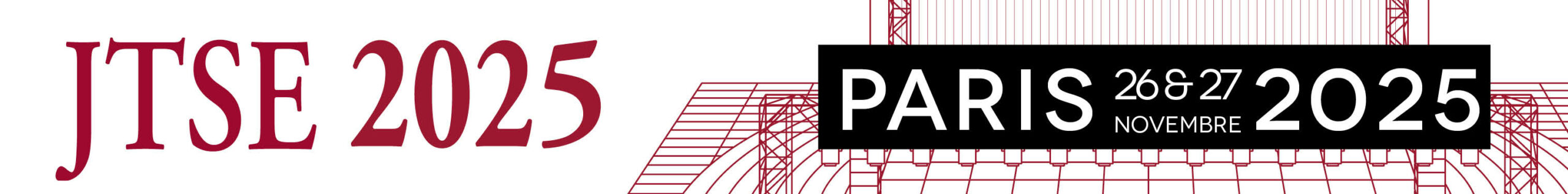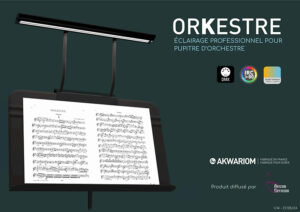“Il va falloir inventer d’autres manières de pratiquer nos arts”
Le chorégraphe Jérôme Bel et ses équipes assurent ne plus prendre l’avion pour leurs tournées depuis deux ans afin de limiter leurs impacts carbone. Particulièrement préoccupé par le sort de la planète, l’artiste tient un discours sans concession sur ses consœurs et confrères qui ne prennent pas en compte les problématiques écologiques dans leurs réalisations.
Votre dernière création, Danse pour une actrice, a notamment été présentée en streaming en raison de la crise sanitaire. Que pensez-vous de ce moyen de diffusion “contraint” ?
Jérôme Bel : Je trouve cela intéressant si nous pouvons y réfléchir. En effet, il y a un abîme qui sépare l’expérience théâtrale et l’expérience digitale. Nous ne parlons même plus de cinéma. Il faut penser à partir du petit écran de l’ordinateur, du contexte de la maison où se déroule cette expérience, maison habitée par d‘autres individus parfois, où les possibilités de faire autre chose sont multiples alors qu’au théâtre, le public est comparativement… prisonnier. Quand le Théâtre Sorano et La Place de la Danse à Toulouse nous ont proposé de faire un streaming,