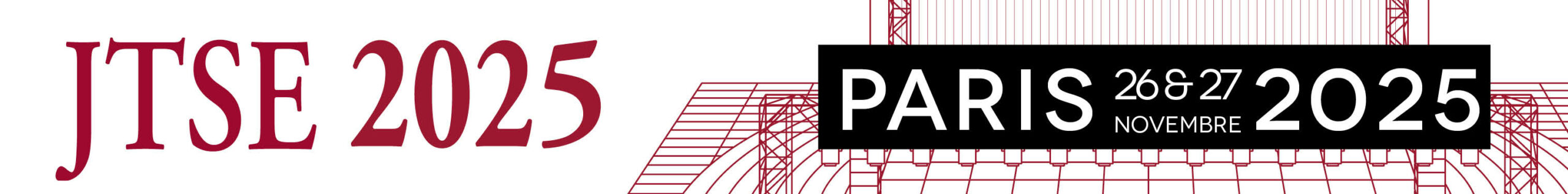“L’écologie peut inviter à interroger les manières de faire de l’art.”
Julie Sermon est professeure en histoire et esthétique du théâtre contemporain à l’Université Lyon 2. Dans Morts ou vifs (Éditions B42, 2021), elle s’intéresse à l’influence que peut avoir la question écologique sur les façons d’écrire, de mettre en scène, d’interpréter et de produire du spectacle vivant aujourd’hui.
Quel a été le point de départ de la rédaction de Morts ou vifs ?
Julie Sermon : L’impulsion première de ce livre a été l’arrêt brutal de toutes les activités déclarées “non essentielles” lors du confinement du printemps 2020. D’un point de vue très prosaïque, l’annulation ou le report d’un certain nombre de projets sur lesquels j’étais engagée m’a permis de me libérer du temps pour me consacrer à l’écriture. J’ai alors eu l’occasion de mettre en forme des réflexions et d’approfondir des questionnements sur lesquels je travaillais depuis trois-quatre ans. À l’origine, je n’avais cependant pas prévu d’en faire un ouvrage. Il s’agissait pour moi d’un travail de recherches préparatoires, mené dans le cadre de mes enseignements et de mes activités universitaires. Le contexte social et politique ambiant (fermeture des théâtres, prise de conscience