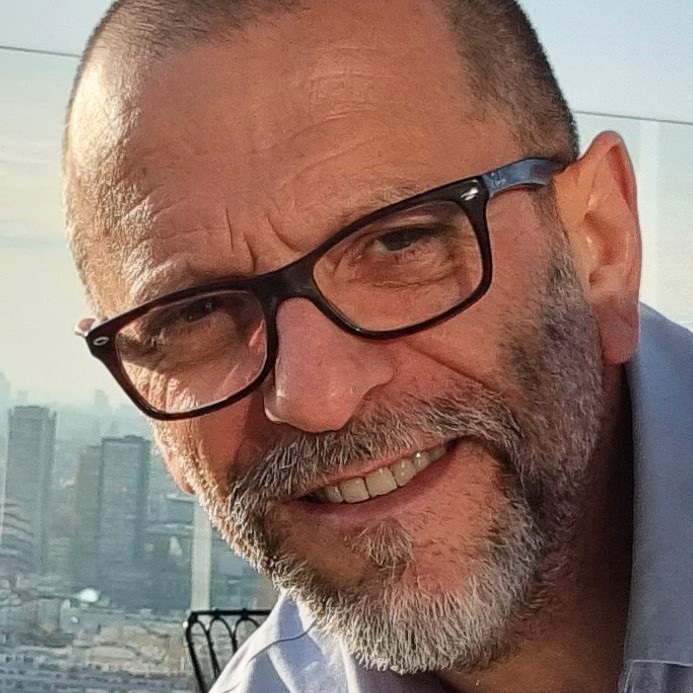Auditorium Maurice Ravel
Toutes les photos sont de © Patrice Morel
Cet espace de diffusion de musique classique s’intègre parfaitement dans une topographie industrielle située entre fer et mer. L’espace, à la fois graphique et lumineux, propose une acoustique continue particulièrement vivante. Un des points forts tient à l’intégration de nombreuses passerelles numériques de dernière génération, un maillage audiovisuel particulièrement efficace reliant astucieusement les différents pôles d’activité du CRI (Conservatoire à rayonnement intercommunal).
Tour d’horizon
Cet établissement regroupe plusieurs pôles d’activités dont un auditorium classique de 2e catégorie du type L, salle d’audition et salle de spectacle. L’espace propose une configuration frontale à volume unique sans cadre de scène. Aucun dispositif de machinerie n’ayant été requis, les projecteurs et autres équipements scéniques prennent place sur une série de porteuses doubles fixes, implantées à des altimétries variables, établies entre 6,16 m pour la plus basse et 7,82 m pour la plus haute. Les locaux techniques ne comportent aucun gradateur d’éclairage scénique ; les futures préconisations en matériel d’éclairage devront s’inscrire dans une démarche écoresponsable. Néanmoins, une prise d’alimentation 32 A implantée côté cour autorise, le cas échéant, l’utilisation d’un équipement temporaire ad hoc. Les régies sont installées dans l’axe au niveau du