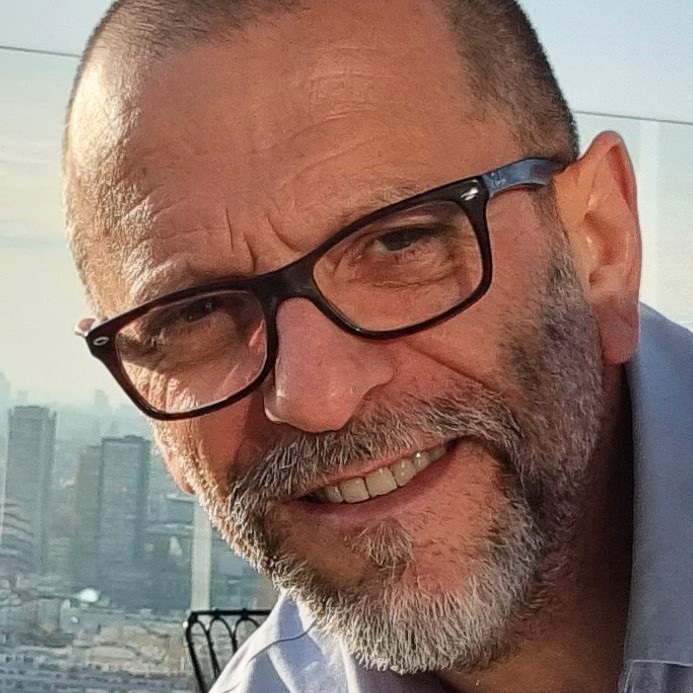L’Opéra d’Avignon fait peau neuve
Toutes les photos sont de © Patrice Morel
Cette dernière mise à jour tend à améliorer le confort du public, la qualité d’écoute et l’accessibilité. Parmi les nombreuses interventions répertoriées au lot scénographique, nous comptons l’agrandissement substantiel de la fosse d’orchestre, le renouvellement de la diffusion sonore, l’automatisation des équipements scénotechniques associés au renouvellement des réseaux audiovisuels.
Avant-propos
La lecture très habile du projet a conduit à un large périmètre d’intervention. Félix Lefebvre et Noémie Boggio de l’agence Kanju ont su se mettre à la portée des futurs utilisateurs. D’ici quelques semaines, ces derniers devraient être en mesure de tester, en situation, la totalité des fonctionnalités.
Certains équipements préexistants ont été conservés et réhabilités, comme par exemple les tables élévatrices du proscenium et la structure du plateau détrapable à inclinaison motorisée. D’autres ont été entièrement déposés, à l’instar des anciens équipements de machinerie manuelle, des réseaux scéniques analogiques devenus pratiquement obsolètes. Sans oublier la livraison d’équipements neufs tels que le monte-décor à l’arrière-scène côté cour, la motorisation des cintres, la création du gril de proscenium, de la galerie de poursuites, …