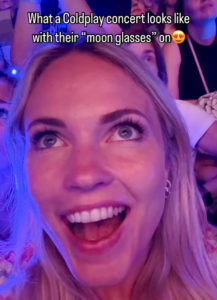Orchestre d’un genre nouveau
C’est le mariage de l’entomologie et de l’organologie. C’est l’histoire d’un graphiste, Mathieu Desailly, d’un scénographe, Vincent Gadras, et d’un musicien, David Chalmin. C’est la joyeuse idée du graphiste lancée à la volée : construire un scarabée avec un piano pour répondre à une commande d’art contemporain. C’est devenu un orchestre mécanique d’invertébrés épatants, mi-insecte(s), mi-instrument(s). C’est un bestiaire utopique nommé Anima (Ex) Musica qui se promène de ville en ville et s’installe avec son atelier mobile. Le Collectif TOUT/RESTE/À/FAIRE fait étape à Brest.
Bestiaire utopique
Le téléphérique urbain survole la rade de Brest pour se poser au pied de l’Atelier des Capucins. La gare du téléphérique est le point d’arrivée sur cet imposant site (il fut couvent puis fonderie) joliment reconverti. C’est une cigale géante de Bornéo (Megapomponia merula) qui ouvre le bal. Le lieu est un peu vaste pour le bestiaire mais elle active ses ailes au son d’une mélodie délicate. À quelques pas de là, une boîte au gris lumineux et à l’allure impeccable détaille, avec la redoutable et élégante précision des planches anatomiques, les instruments utilisés pour fabriquer la bête : trente-cinq archets, seize violons, un alto, neuf violoncelles, une contrebasse, un harmonium,