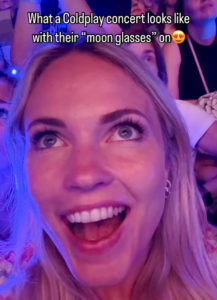Nous avions l’habitude de voir la frêle silhouette de Jean Perrottet, montant les marches des théâtres, il n’y a pas si longtemps encore. Avec Valentin Fabre, ils ne concevaient pas uniquement des salles de théâtre ; ils les fréquentaient assidûment et avaient pour habitude de citer des pièces pour parler de leur architecture. Infatigable, Jean Perrottet continuait de travailler, dessinant sur ses calques, expliquant des faisabilités de projets, critiquant des programmes, effectuant des relevés dans les théâtres à l’âge où de nombreux collègues avaient déjà arrêté leurs activités professionnelles. Alors, imaginer qu’un jour il nous quitterait, c’était impensable.
Une figure de l’architecture théâtrale
Les noms de Jean Perrottet et Valentin Fabre sont totalement, intimement, inexorablement liés à l’architecture théâtrale. Avec plus de vingt-cinq édifices de théâtres construits, réhabilités et rénovés, le paysage de l’architecture théâtrale français a été profondément influencé par le renouvellement spatial du théâtre que Fabre et Perrottet ont insufflé depuis les années 60’. Parmi ces théâtres les plus emblématiques, comptons le Théâtre de la Ville en 1968, le Théâtre de Chaillot, Les Gémeaux à Sceaux, le Théâtre d’Angoulême, le Théâtre de Sartrouville, celui de Colombes, la