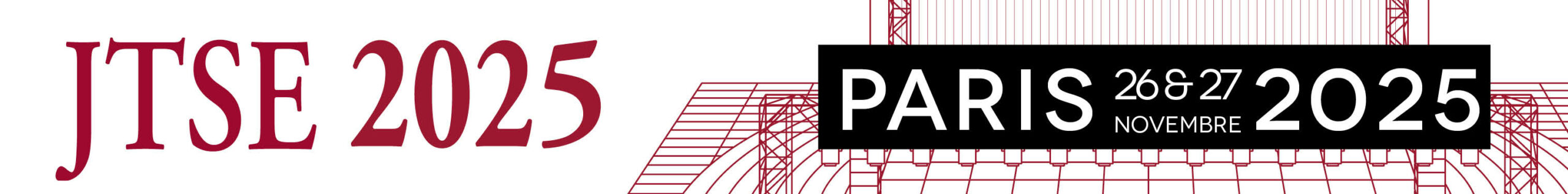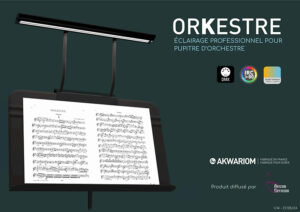“Le besoin de culture naît d'un besoin de consolation”
Le philosophe Michaël Foessel est Professeur à l’École polytechnique. L'auteur du Temps de la consolation revient avec nous sur les mouvements de recueillement qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Des attaques qui ont ciblé un mode de vie et des pratiques culturelles. AS : La consolation est le sujet de votre dernier ouvrage. Pouvez-vous nous en donner votre définition ? Michaël Foessel : La consolation désigne les discours et les actions qui consistent à apporter une réponse à la douleur et à la perte de l’autre. C'est une chose compliquée car le consolateur n'a pas le même ressenti de douleur ou de perte que la personne faisant l'objet de cette consolation. Il s'agit pour le consolateur de répondre à celui qui ressent cette perte en première personne. Cela peut réconforter, mais cela n’abolit pas la douleur. On peut définir la consolation comme l'ensemble des gestes et des actes qui ouvrent une alternative à la mélancolie. Selon vous, que disent de notre rapport culturel au recueillement les mouvements d'hommages qui se sont manifestés dans toute la France suite aux événements du 13 novembre ? D'abord, cela montre qu'il existe un besoin de consolation qui ne touche pas uniquement celles et ceux qui ont été