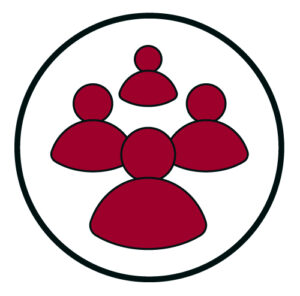“Regarder, c’est choisir.”
La septième édition du Video Mapping Festival a eu lieu du 4 au 7 avril à Lille. Avec une sélection de vingt mappings sur huit sites, l’événement a attiré plus de 250 000 visiteurs. Dans les jours précédant le Festival, les conférences Image Beyond the Screen ont réuni 350 professionnel.le.s du milieu pour trois journées de rendez-vous hétérogènes : tables rondes, keynotes, groupes de travail, talent connections, remises de prix, … Au fil des années, cet événement a donné naissance à une véritable communauté internationale. Confrontant des perspectives artistiques, économiques et techniques, le Video Mapping Festival dresse un état des lieux sur la pratique et ses évolutions. Il offre une opportunité de rencontres et d’échanges actifs, en proposant de réfléchir collectivement au(x) futur(s) du vidéo mapping.
L’image au-delà de l’écran
- Du mapping à 360°
Organisé par l’association Rencontres Audiovisuelles, sous la direction d’Antoine Manier, le Festival s’inscrit dans une programmation d’événements se déployant tout au long de l’année dans les Hauts-de-France. Ici, le mapping se fait à 360° : projections, formation, recherche, résidences. Cette action pluridisciplinaire sur le territoire commence en 2017, quand les Rencontres Audiovisuelles fondent le