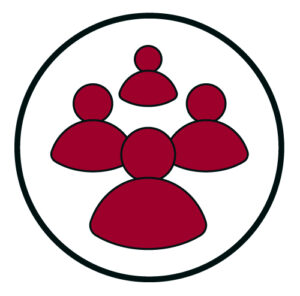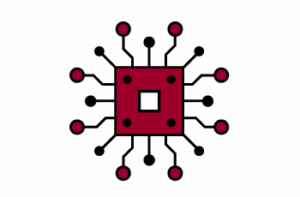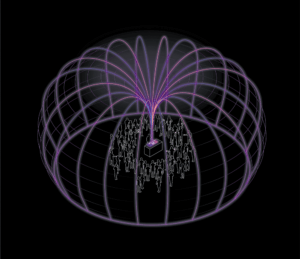“Repenser les modèles de production.”
Enseignante-chercheuse à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris III, Claire Dupont a fondé Prémisses en 2017. Cet office de production artistique, s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et solidaire, accompagne de jeunes créateurs du spectacle vivant durant plusieurs années et a pour objectif de favoriser leur insertion et la structuration de leurs projets professionnels.
Dans quel contexte est né le projet Prémisses ?
Claire Dupont : La production est l’ADN de ma carrière. J'ai accompagné des artistes en production durant de nombreuses années, participé à l’émergence de ma génération ; j’ai accompagné Pauline Bureau, Julien Gosselin, …
Parallèlement, j’ai mené une carrière universitaire et je suis maître de conférence associée à l’Université Paris III, à l’Institut d’études théâtrales, où je codirige un Master II intitulé “Métiers de la production théâtrale”.
En 2015, j’ai commencé à réfléchir à un nouveau modèle de production pour les très jeunes créateurs. J'étais très sollicitée. Les écoles nationales s’étaient énormément développées et il y avait de plus en plus de comédien.ne.s sur le marché. Des personnes qui se rapprochaient pour ne pas être seules et générer leurs propres activités. Évidemment, personne n’était là pour accompagner les