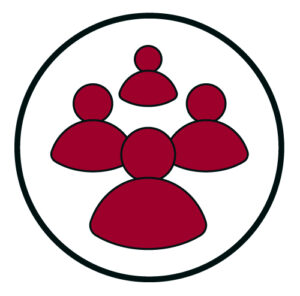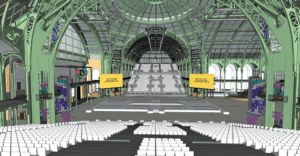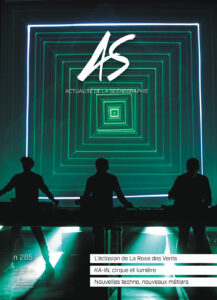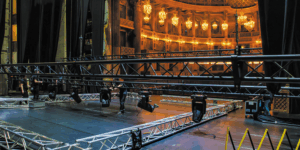Camera Ballet s’est installée dans les espaces du Plateau, au FRAC Île-de-France depuis fin septembre. Conçue comme un travelling sans fin, la scénographie invite les publics à prendre part aux œuvres, comme c’est régulièrement le cas dans les propositions de la commissaire Céline Poulin, mais aussi à prendre de la distance face à ces œuvres surdimensionnées. L’exposition qui possède, à de nombreux endroits, des modes de présentation issus de la scénographie théâtrale, se joue de cette mise à niveau constante de nos regards. Elle nous invite alors à la désacralisation de l’objet-peinture qui traverse tous ses états âme ici.

Jeu d’échelles
Comprendre l’espace du Plateau du FRAC Île-de-France comme une “scène géante”, c’était déjà toucher à la notion d’échelle de ces anciens studios d’enregistrement d’émissions de télévision. Si de très nombreuses pièces ont été faites à l’occasion de l’exposition, dans l’idée des volumes du FRAC, Mathilde Denize confie que les proportions sont toujours perçues “au-delà des limites du corps humain afin d’entrer dans un imaginaire forcément plus ouvert”.(1) Pourtant l’objet-maquette n’est jamais véritablement convoqué, ni à l’échelle du lieu en amont de la fabrique de l’exposition, ni dans la confection des œuvres. C’est grâce à cette conception de l’art non finito chère à Mathilde Denize, dessinant une œuvre sans fin, en perpétuelle renaissance, qu’une liberté formelle existe dans ses pièces. La mise en volume de la peinture et des formes avec la modéliste Rosalie Gesta permet d’envisager techniquement “un espace du costume avec davantage de liberté, jusqu’à l’ajout de nombreux détails que l’échelle du corps humain ne permettrait pas”, explique-t-elle. Emprunté au vocabulaire de la scène, le lexique de l’exposition décale ainsi de manière continue l’action et nos regards des espaces du FRAC au centre même d’œuvres, autrement appelées “tableaux-théâtres”.(2)

Le parcours d’un travelling sans fin
Dès le début du parcours, les publics sont invités à suivre des yeux une frise qui lie, grâce à la gamme chromatique, l’ensemble des œuvres qu’ils rencontreront au cours de la visite. Elle donne le ton “d’un paysage”, explicite Mathilde Denize et fabrique ce travelling sans fin. Les salles sont ainsi construites comme des décors de cinéma, fabriquées de toutes pièces, à la différence près que les œuvres exploitent manifestement la fonction et l’usage des mobiliers de coutume. Le parcours suggéré aux publics, à la manière d’une caméra, traverse les différentes pièces sans interruptions, rencontrant ces cimaises coupées qui fabriquent ces faux-murs à l’endroit du passage de la caméra. Toutefois, la création de ces nouveaux murs n’est pas le fruit de l’installation de cimaises, mais des toiles qui, grâce à des châssis suspendus, agissent comme telles. Mathilde Denize explique que “la création de ces murs, et donc de ces nouvelles pièces, est le fruit de ses réflexions quant à l’idée de tableaux recto-verso qui s’accrochent dans les airs et permettent la fabrique de différents points de vue”. Une fois la caméra posée, les murs des décors installés, il ne manquait plus que les socles des sculptures à réaliser, finissant le parcours et la mise en scène.

Désacralisation du médium & scénographie des corps invisibles

Récemment, Céline Poulin rappelait son fantasme “d’aller dans un lieu d’art avec la même facilité qu’à la bibliothèque, que cela fasse partie du quotidien”.(3) Face aux appels répétés des publics rencontrés à l’issue d’expositions précédentes, la mise à disposition d’un vestiaire au sein de l’espace de pratique libre, qui fait office d’introduction à l’exposition, a trouvé toute sa place. L’art rencontre alors le vêtement au FRAC Île-de-France grâce à Mathilde Denize qui propose ses propres costumes et amène les publics à une séance d’essayage voire au jeu dans les espaces d’exposition. L’interaction des publics avec les pièces réalisées rencontre alors la volonté “d’étirement de la peinture jusqu’à la désacralisation du médium”, explicite Mathilde Denize. Une dimension que rejoint pleinement le fondement de sa pratique : “J’ai toujours fonctionné en réemployant parce que c’était plus simple de réutiliser les choses et non pas de les acheter en vue de faire quelque chose ; cela me permet d’être plus directe dans mon geste et moins angoissée à l’idée du ratage”. D’une scène désacralisée à l’idée d’une pratique de l’art selon le format du non finito, ce sont finalement “les corps invisibles que fabriquent les toiles qui ont donné forme à la scénographie” et caractérisent l’exposition de Mathilde Denize qui prolonge encore les nombreuses conceptions pensées de l’art de l’écriture de l’espace.
(1) Extrait de l’entretien téléphonique mené avec Mathilde Denize le 28 octobre 2025
(2) Extrait du Journal de l’exposition du FRAC Île-de-France, le Plateau
(3) Extrait de l’entretien téléphonique mené avec Céline Poulin le 06 mars 2025