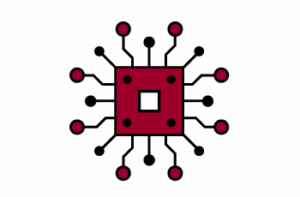Cirque itinérant et écoresponsabilité
Un budget d’un million d’euros a été dédié au projet de recherche et développement intitulé “Vers un éphémère durable”, initié par le CIAM d’Aix-en-Provence. Lancé officiellement en mars 2024, ce projet de trois ans a pour objectif de créer un prototype de chauffage décarboné, écoresponsable et industrialisable pour les chapiteaux itinérants, afin de remplacer le chauffage au fioul utilisé par une grande majorité des chapiteaux de cirque en tournée actuellement. Cet article vise à expliciter le contenu et explorer les contours de ce projet d’envergure.
Montage du projet
Le Président Macron a lancé, en 2021, le plan d’investissement France 2030 dans le but de financer massivement les technologies innovantes pour la transition écologique. 54 milliards d’euros ont ainsi été investis par le Gouvernement français dans de multiples domaines. L’un des appels à projets de ce programme est spécifiquement tourné vers les activités culturelles avec l’intitulé “Soutenir les alternatives vertes dans les industries culturelles et créatives”. Le CIAM (Centre international des arts en mouvement) d’Aix-en-Provence est lauréat de cet appel à projets, en partenariat avec l’entreprise Capgemini. Le projet “Vers un éphémère durable” est officiellement lancé en mars 2024, avec