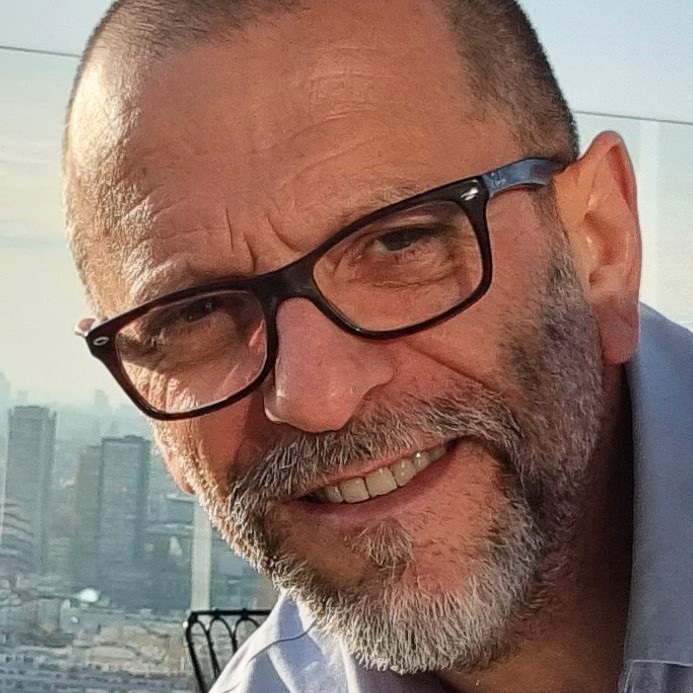Le Théâtre de Beaulieu
Toutes les photos sont de © Patrice Morel
Depuis son ouverture en 1954, aucune rénovation sérieuse n’avait pu être engagée. Le Théâtre de Beaulieu, jusqu’à sa fermeture définitive en 2019, n’était qu’une extension du Palais des congrès. Certaines servitudes et l’étroitesse du plateau entachaient le bon fonctionnement des zones de production. La surélévation et l’élargissement de la cage de scène apportent une certaine verticalité et un rendu pour le moins bluffant. Doté d’un nouveau système de machinerie entièrement informatisé, d’un décor d’orchestre de scène couplé au système Amadeus Active Acoustics, de réseaux numériques de dernière génération, cet espace de diffusion fait un bond technologique en avant sans précédent.
Avant-propos
Depuis sa construction, le Théâtre ne disposait pas d’accès indépendant ; le visiteur devait se rendre à l’entrée principale du Palais des congrès pour y accéder. Les espaces réservés au public ont été entièrement repris et sont en correspondance avec les différents niveaux du Théâtre. Certaines communications transversales, préexistantes entre les deux entités, ont néanmoins pu être conservées. C’est le cas, par exemple, du dégagement technique situé en sous-sol qui organise l’approvisionnement et les échanges de matériel depuis