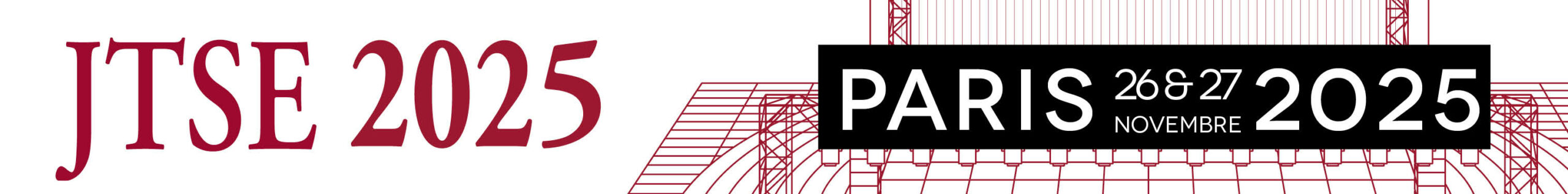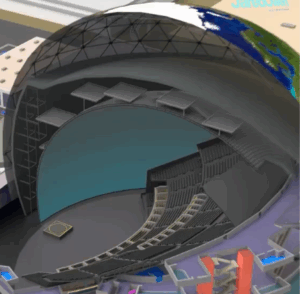La Biennale des Imaginaires Numériques, qui s’est tenue du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2023 entre Marseille, Aix-en-Provence et Avignon, est un événement qui “s’intéresse à la présence et l’usage du digital et des nouvelles technologies dans l’art”. Cette année, la troisième édition avait pour thématique “la nuit”. Cet article revient sur trois expositions programmées à la Friche la Belle de Mai à Marseille.
Dedans/dehors
Peut-être que la visite d’une exposition, davantage qu’un spectacle, est poreuse ou sensible au trajet qui nous amène jusqu’à son lieu. Je ne sais pas si c’est toujours le cas. Pour ce qui est de la Biennale des Imaginaires Numériques à la Friche la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement de Marseille, cela m’a particulièrement frappée. Le trajet qui va de la gare Saint-Charles à la Friche, je l’ai fait à pied ; il y a aussi les longues rues et ce passage sous les rails ; mais il y a surtout la Friche elle-même. Dès que nous passons l’entrée de la cour, nous entendons les cris des enfants qui jouent au basket, de celles et ceux qui ride. La proximité des rails et les trains réguliers ; les bâtiments : ancienne manufacture nationale des tabacs, grandes