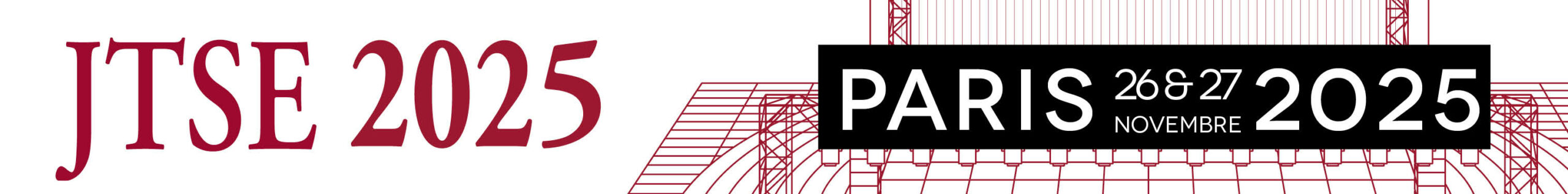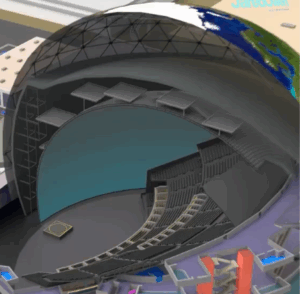Écrire la scène, sculpter l’espace
Au générique de sa dernière mise en scène Institut Ophélie, elle apparaît comme scénographe. Elle est passionnée par la peinture, gourmande d’art dont elle se délecte et qu’elle nous livre avec délice. Elle a l’œil qui frise et l’esprit qui voltige. Elle a fait ses armes en créant un festival – Vues d’ici, scénographie d’un lieu – à l’École spéciale d’architecture qu’elle squattait et en travaillant dans des camps de réfugiés palestiniens au Liban. L’option théâtre au lycée, un appétit pour la scène, pas nécessairement pour le jeu d’ailleurs, la confirme dans son chemin vers l’art théâtral. Une joie à la découverte de la conception et de la fabrication, l’espace, les formes, l’écriture scénique la guideront vers la mise en scène.
Le théâtre, pas à pas
Le théâtre, ce n’était pas prévu. Nathalie Garraud était en section scientifique mais c’est l’option théâtre du lycée qui l’appâte, selon un schéma qui a fait ses preuves : la rencontre avec un professeur inspiré à la marge des programmes. Chaque année, une pièce est montée avec les élèves de l’atelier. Terrain d’essai, foisonnement collectif, son désir le pousse jusqu’à transformer deux salles de classe en théâtre. “Il était passionné par le début du siècle et