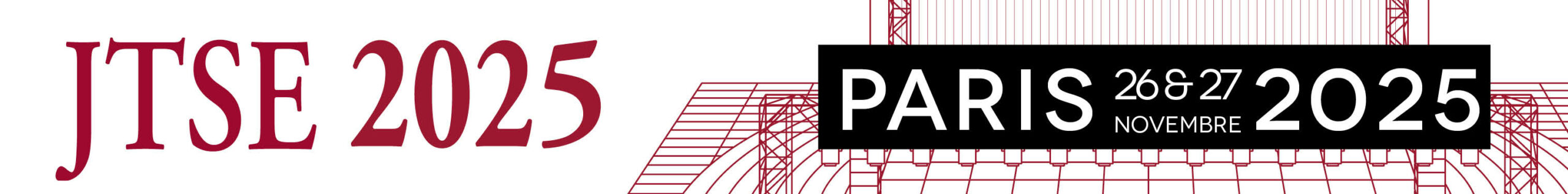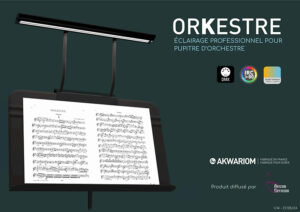Festival d’Avignon
Toutes les photos sont de © Christophe Raynaud de Lage
Le Moine Noir, d'après une nouvelle d'Anton Tchekhov, retrace l'histoire d'un intellectuel russe, Andreï Kovrine, qui, surmené, vient trouver refuge dans le grand jardin de celui qui l'a quasiment élevé, Péssôtski. Il y retrouve Tania, la fille de ce dernier. Ils vont se marier. Le père et la fille éprouvent une vive admiration pour Andreï mais celui-ci voit de plus en plus venir à lui, dans un délire hallucinatoire, un moine noir. Il va peu à peu sombrer dans la folie et finira par mourir. Ce jardin est la seule chose que possèdent Péssôtski et Tania ; il est toute leur vie.
Kirill Serebrennikov – auteur metteur en scène et scénographe du spectacle – part de la nouvelle éponyme d'Anton Tchekhov et propose un montage où vont se succéder les points de vue de différents personnages sur l'histoire racontée. Le spectacle est structuré en quatre parties. Au départ de chacune d'elles, le chiffre (1, 2, 3, 4) est projeté en grand. L'architecture est on ne peut plus claire. Comme le fait Gus Van Sant dans Elephant en octobre 2003, nous