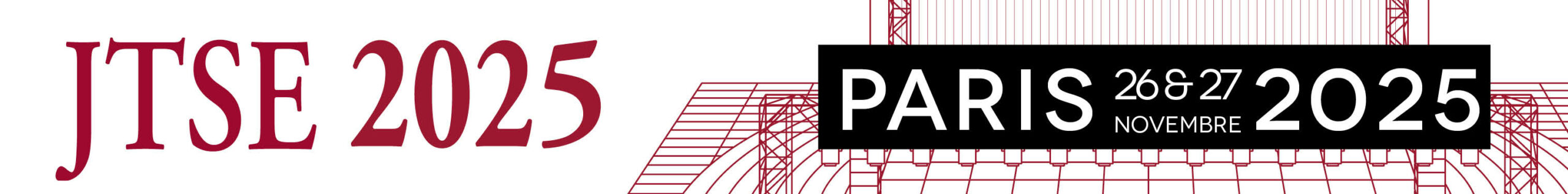La tête et le cœur
Elle a le regard bleu profond comme le bleu de l’océan. Sa veste et ses cheveux sont bleus aussi. Au théâtre, comme à l’opéra, impossible de parler de masques sans que son nom ne revienne dans toutes les bouches. Au cinéma, elle a réalisé les masques en papier mâché du film d’Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Elle nous accueille dans son atelier parisien, comme à la maison, sa fille au modelage, son mari, discret, affairé à l’autre bout de la pièce. L’endroit est inspiré et inspirant. La conversation commence ainsi : “Je vous préviens, quand je parle de mon métier, je suis terriblement bavarde”. C’est vrai. Elle est épatante, concentrée, vivante, l’œil vif et le cœur ouvert. Verbatim.
Cécile Kretschmar : J’ai obtenu un CAP de coiffure à seize ans et donc de seize à dix-huit ans, j’ai été coiffeuse. Ma relation avec le théâtre, je la dois à ma mère, Marie-Hélène Butel. Elle a fait l’école du TNS, en scénographie/costumes, dans le groupe 4, à l’époque d’Hubert Gignoux. Elle n’a jamais fait carrière au théâtre. Elle a beaucoup travaillé, a eu des enfants, c’était une autre époque. Elle a, en revanche, toujours gardé un contact avec