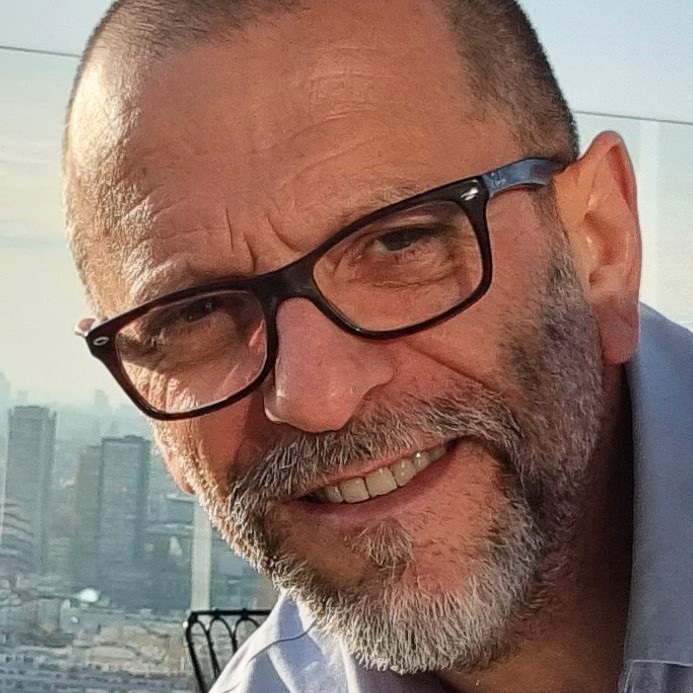Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
Toutes les photos sont de © Patrice Morel
Difficile de croire qu’il est possible d’intégrer autant d’équipements et de fonctionnalités dans une parcelle aussi restreinte. Vu sa situation au plan vertical et comme en témoigne la coupe longitudinale, l’exercice de style est d’autant plus étonnant. L’enfouissement du parterre à presque 5,50 m au-dessous du niveau du sol est une des clés de la réussite du projet. Ces attendus ont permis de produire un ensemble scénotechnique à haute valeur ajoutée et de déployer un dispositif de machinerie entièrement dégagé du pouliage, le tout étant servi par une technologie numérique dernière génération.
Les principales fonctionnalités
Échange avec Jacques Moyal (Architecture & Technique) et Thomas Bordelais, directeur technique adjoint
La destination première tenait au fait de réussir à livrer à l’utilisateur final un espace de répétition modulable transformable de 500 places. Conformément à la demande initiale de l’exploitant, l’espace brut de 21,60 m de large x 30 m se présente sous la forme d’un espace scénique intégré à la salle, sans espace scénique prédéterminé. Le volume est doté d’un gril de charge et d’un gril de marche séparés, l’ensemble recouvrant