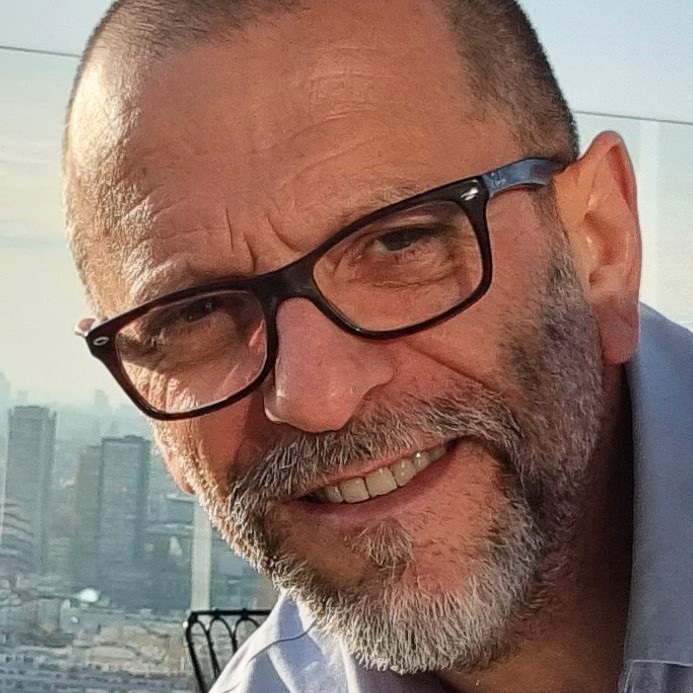Toutes les photos sont de © Patrice Morel
Château Rouge est une Scène conventionnée qui développe une activité de centre culturel. La nouvelle extension, prévue de longue date, est l’aboutissement d’un long travail de réflexion. À la fois sobre et robuste, l’espace scénique aux tons gris sur fond noir déploie des caractéristiques dimensionnelles impressionnantes. Ses principaux volumes bénéficient de réserves et de disponibilités aptes à faire face aux évolutions technologiques, à l’installation d’équipements complémentaires, conditions d’exploitation qui devraient faire le futur de ses vingt prochaines années.
Avant-propos
Échange avec Gérard Mansis, directeur technique
Château Rouge est un lieu emblématique proposant une programmation ambitieuse dont les productions, hélas, n’ont jamais vraiment trouvé leur place dans l’ancienne configuration. Une inadéquation chronique à laquelle venaient s’ajouter des conditions d’isolement acoustique et thermique pratiquement inexistantes. Le voisinage subissait des nuisances sonores engendrées par l’activité, tandis que le public vivait certaines représentations au rythme des impacts des précipitations ricochant lourdement sur le dôme de la toiture.
Chaque production représentait une masse de travail pour l’équipe d’accueil, équivalente à la réalisation d’une date de spectacle en plein air. Ces exploitations engendraient nombre de complications, […] un