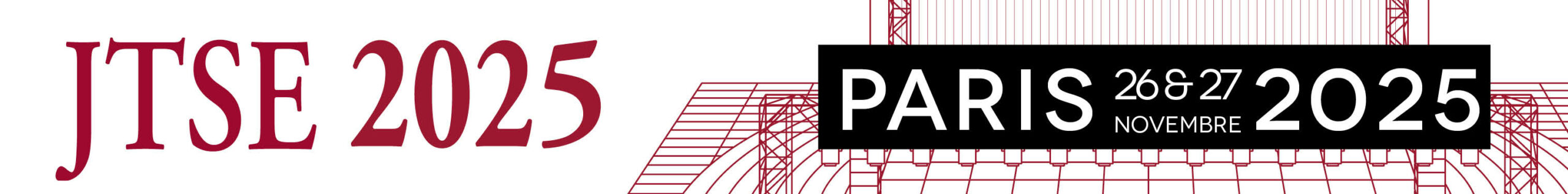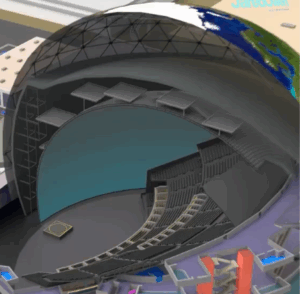Expériences
- “Vous vous sentez surtout quoi Gisèle Vienne ? Plasticienne, metteuse en scène, photographe, musicienne ? Je crois que vous êtes une merveilleuse harpiste. Où est la vraie Gisèle Vienne ? Ou alors ça n'a pas d'importance ces étiquettes ?”
- “C'est drôle ! Je pense que Bob Wilson, Pina Bauch ont révélé l’absurdité de ces catégorisations et en 2021, la question se pose encore !”(1)
Inclassable en effet
Après avoir v(éc)u l'Objet scénique non identifiable, il est effectivement difficile de mettre cette œuvre dans une case... à moins d'en créer une. Pour mieux sonder L’Étang, d’après un texte de Robert Walser, l’éclairagiste du spectacle Yves Godin nous parlera de son élaboration et de la méthode Gisèle Vienne pour aboutir à ce résultat hybride et totalement immersif.
Le pitch
Fritz, un adolescent dans toute sa complexité, décide de mettre en scène son suicide par noyade pour tester l'amour maternel. Robert Walser oppose la pureté de l'adolescence à la perversité des adultes. Et l’inceste, en filigrane.
L’expérience, vue extérieure
Tout au long du découpage en huit épisodes structurant l’expérience, Gisèle Vienne s'emploie, selon ses mots, à “déplier le réel”. Non pas pour