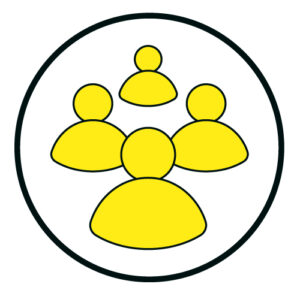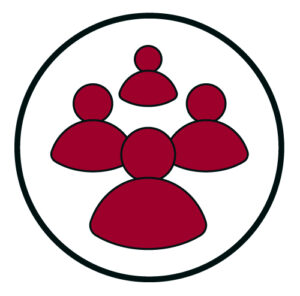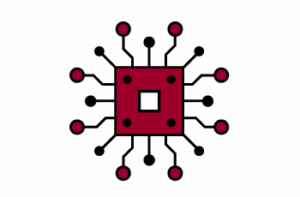Un festival numérique aux multiples facettes
Depuis 2016, la ville de Metz a décidé de sublimer, durant l’été, son patrimoine architectural par le biais d’un festival mêlant street art, installations urbaines et arts numériques. Après l’annulation de l’édition 2020 suite à la crise de la Covid-19, la cinquième édition du festival Constellations s’est déroulée autour du thème “L’eau dans l’espace, la vie ailleurs”. La programmation entend offrir un regard renouvelé sur la création numérique d'aujourd'hui et sur la richesse de ses formes. Le très attractif mapping de la Cathédrale côtoie ainsi des propositions plus originales exposées dans des espaces plus intimes.
Une programmation diversifiée
Le parcours numérique ouvre ses portes au public les jeudis, vendredis et samedis, de la tombée de la nuit à une heure du matin pendant les mois de juillet et août. Le point d’information du Festival, établi dans un bureau éphémère posé sur la placette devant l’Opéra-Théâtre, est surmonté d’un laser haute puissance blanc pointé sur un bâtiment situé 200 m plus loin, en direction de la Cathédrale. Nous en rencontrerons trois autres au gré de notre cheminement. Ces puissants faisceaux matérialisent, dans l’air, la forme du parcours, créant une signalétique directionnelle aérienne. Autre originalité visuelle, des