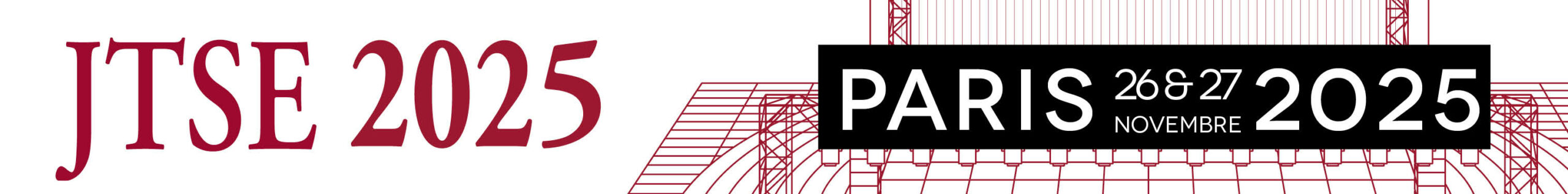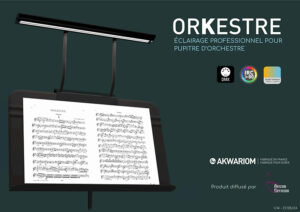Scénographe, éclairagiste, Seymour Laval est avant tout un homme inconditionnel du plateau. Malgré qu’il soit “tombé dedans quand il était petit”, avec une mère comédienne et un père metteur en scène, il sillonne inlassablement les scènes de théâtres, remettant à chaque fois son ouvrage.
Seymour Laval : Enfant, on vivait dans les théâtres, on dormait dans les théâtres, je voyais toutes les pièces. Ce n’était ni agréable ni désagréable, c’était la vie normale. Mon père en parlait tout le temps, comme moi à mes gamins, parce que c’est quelque chose de la vie de presque tous les jours. Les papas metteurs en scène racontent des histoires, travaillent la nuit, ce sont presque des super-héros. Je n’ai jamais voulu faire cela, jusqu’au Bac. Je ne m’étais pas inscrit à la fac, je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire. Puis ma mère m’a dit : “Je connais des techniciens de théâtre”. Forcément, puisqu’elle ne connaissait que ça... J’ai donc commencé à travailler avec Yves Charton et Jean-Louis Delorme, son technicien à l’époque. C’est vraiment là que j’ai eu le déclic. On jouait un spectacle en extérieur au Fort du Bruissin, à côté de Lyon. Le Théâtre du Point du Jour nous avait prêté une sorte de gradin en