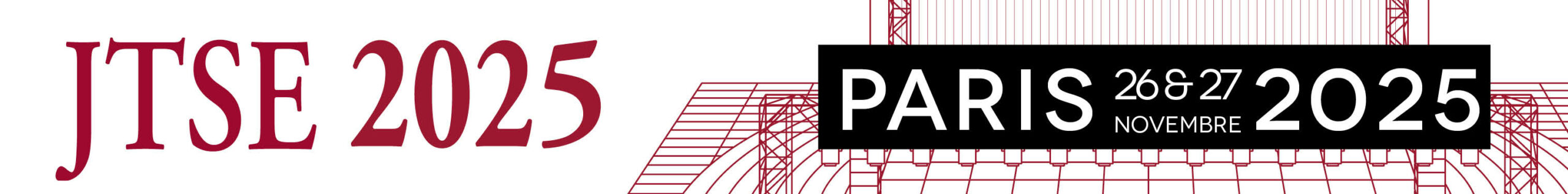“L'artiste n'a pas à justifier ce qu'il fait”
Elsa Vivant est maître de conférences en urbanisme à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle travaille sur la place de la culture dans les projets urbains et sur la façon dont elle peut être utilisée comme moyen dans le cadre de ces projets. Elle s'est également intéressée au concept de ville créative auquel elle a consacré un ouvrage. Interview. AS : Vous critiquez le concept de “classe créative” défini par le chercheur américain Richard Florida. De quoi s'agit-il ? Elsa Vivant : Il s'agit d'un terme controversé qui, finalement, recoupe ce que l'appareil statistique français désigne par les “catégories professionnelles intellectuelles et supérieures”. Ce qui est critiquable, c'est la façon dont Florida crée des généralités en utilisant cette appellation. Il n'était pas nécessaire d'inventer un nouveau vocabulaire. Or, ce que ce vocabulaire sous-entend, c'est le rapprochement supposé des modes de vie, des goûts et des contraintes professionnelles des artistes, des travailleurs de la Silicon Valley, de la finance ou encore des médecins, alors que ces personnes rencontrent des réalités professionnelles très différentes les unes des autres. Vous faites une distinction entre les “créatifs” et les “créateurs”. Qu'est-ce qui distingue ces deux catégories ? Pour Florida, les créatifs sont tous